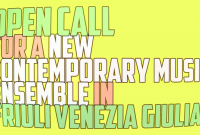Un entretien avec Anne Teresa De Keersmaeker
au sujet de En Atendant
Jean-Luc Plouvier & Anne Teresa De Keersmaeker
Mai 2010 (Entretien publié dans MMM13),
révision septembre 2022
En relisant l’entretien qui suit, réalisé à l’occasion de la création de En Atendant1 en 2010, je me rends compte que vous viviez alors un moment de grand retournement, une remise en question de votre rapport au monde.
Anne Teresa De Keersmaeker: En Atendant, c’est en effet le moment où tout bascule. Mon premier essai du genre, plus modeste, remontait à Keeping Still en 2007. Nous utilisions le texte de la Charte de la Terre ; sur le plateau, une scénographie très dépouillée d’Ann Veronica Janssens, faite de fumée et de lumière ; et enfin ma propre présence en solo, sans artifice, très exposée. C’était une première approche d’un noeud fondamental à explorer entre la pensée écologique, l’économie des moyens dans la production d’un spectacle, et une certaine qualité de présence physique sur la scène, « sans tricher », ancrée dans les rythmes physiologiques. À plus grande échelle, avec huit danseuses et danseurs, En Atendant reprend et approfondit cette intuition.
À l’époque, le titre du spectacle ne choquait pas particulièrement. Douze ans plus tard, il fait froid dans le dos. En attendant quoi, alors ? Que tout prenne feu ? Ou que les humains repensent enfin leur rapport aux autres terrestres ?
Je donnerais deux sens à cette attente. Le premier est effrayant, en effet, c’est ce moment où chacun suspend son souffle, paralysé. C’est ce moment particulier de l’incendie dont parle Rilke dans Les cahiers de Malte Laurids Brigge : le mur en feu est encore tout dressé, mais on comprend qu’il va tomber en poussières dans les secondes qui suivent. Il y a par ailleurs un sens beaucoup plus doux, plus optimiste. C’est le sens si magnifiquement développé par Barthes dans ses Fragments d’un discours amoureux : l’attente, c’est très spécifiquement la qualité de l’état amoureux lui-même. Aimer l’autre, c’est l’attendre.
L’ÉCRITURE DES ÉTATS TRANSITOIRES (entretien de 2010)
En choisissant des oeuvres d’Ars Subtilior, cette pointe de l’Ars Nova de la seconde moitié du XIVe siècle, vous vous attaquez à l’une des musiques les plus complexes qu’on ait vu germer en Europe : un raffinement extrême, des dissonances expérimentales, des jeux de citations et surtout, surtout, une sophistication rythmique qui donne bien du fil à retordre aux musiciens, car il n’est pas rare que chacun doive jouer dans une mesure différente.
ATDK : J’ai découvert de l’Ars Subtilior en cherchant, tout simplement, quelle musique s’était développée en Avignon. Or c’est là, loin de Paris, à la cour des papes, ainsi que dans le Nord de l’Italie et à Chypre, que s’est développé ce sublime maniérisme, qui est une musique de haute aristocratie, un art de «petit cercle». Mais cette musique est-elle pour autant sèche, illisible? Pedro Memelsdorff et Mala Punica, qui ont réactualisé ce répertoire, ont prouvé tout le contraire. Memelsdorff la compare à une cathédrale gothique : « Elle n’est pas faite pour que les gens entrent et fassent des calculs. Elle a une proportion extrêmement compliquée et parfaite pour que les gens entrent et soient éblouis ». Proportion, dit-il... Cela reste mon accès aux choses. Je ne quitte jamais un vague fond pythagoricien. Il y a des lois d’auto-organisation dans la nature qui se manifestent à tous les échelons, et dont nos corps témoignent.
Où en êtes-vous, précisément, du rapport entre les corps et la musique?
ATDK : Je retourne à fond au rapport fusionnel. Lisibilité rhétorique maximale! Certains épisodes sont chorégraphiés pas par pas, note par note, partition en main. Il s’agit d’un répertoire pour trois voix : une soprano tient la voix supérieure, le « cantus » - voix mobile, sinueuse, expressive; une flûte prend la voix de « contre ténor », qui commente et contredit; une vielle tient le « ténor », la voix du dessous. Avec une énorme patience, pour les danseurs comme pour les musiciens, nous travaillons du départ : une note, un pas ! Une voix, un danseur ! Le mot d’ordre : « My walking is my dancing ». Car nous allons toujours vers le plus simple, comme je le disais : le mouvement de marche et ses altérations, ses précipitations, ses suspensions. Le rythme du corps qui s’approprie l’espace...
On vous connaît plutôt pour un intense travail du haut du corps...
ATDK : C’est le niveau suivant, le second mot d’ordre : « My speaking is my dancing ». Souffle, parole, expression de soi, c’est une seule chose : c’est l’ouverture du buste. Tout cela se combine et puis, bien sûr, nous visons le moment où nous lâchons la technique... et même la musique. Ne restera que l’air, le vent, le souffle qu’elle nous a donnés.
Au XIVe siècle, en effet, musique et poésie sont étroitement entrelacés, on les distingue à peine. Y a-t-il un poème qui l’emporte, qui oriente le sens de tout le reste?
ATDK : Une célèbre ballade de Philippo de Caserta, « En Atendant », donne au spectacle son titre et son affect particulier. L’évocation de l’attente est un thème poétique fort apprécié à l’époque : en attendant l’amour, l’espoir, l’apparition... Ici, c’est un peu particulier, le poème attaque avec ce vers : « en atendant souffrir m’estuet grief payne » – en attendant, il me faut endurer de grands tourments. Et ce que le poète attend – fort noblement, notez, car c’est un chant sur la dignité de l’attente – c’est d’être désaltéré. La fontaine est trop loin, et l’eau des ruisseaux, « trouble et corrompue ».
Le XIVe siècle n’est pas moins corrompu, il est vrai.
ATDK : L’historienne Barbara Tuchman l’a baptisé « le siècle des calamités ». La Guerre de Cent Ans a déclenché de terribles crises financières, les armées au chômage pillent les villages de leurs frères, et sur tout cela vient s’acharner la peste : les deux tiers de la population sont ravagés. Les gens n’y comprennent rien, ils pensent à un châtiment divin. Pour comble, cette angoisse spirituelle se renforce du grand schisme d’Occident, lorsqu’un antipape s’installe à Avignon. « Un lointain miroir de notre temps », dit encore Tuchman. Je ne ferai pas de grand exposé didactique sur notre XXIe siècle, mais enfin, quelque chose consone.
Si je vous entends bien : c’est désormais le dépouillement qui vous attire. Quelque chose qui convienne à notre époque d’attente : c’est fini de bluffer. Mais dans le même temps, vous revendiquez une écriture sophistiquée, un chatoiement... C’est une contradiction, qui se résout en douceur dans ce mot : subtilior.
ATDK : Oui, c’est exactement cela. L’adjectif «subtilis», au Moyen Age, qualifie d’abord un art de l’intelligence et de l’exploit formel, un art qui surmonte volontairement des contraintes énormes. C’est d’abord ça. Mais cette musique subtilior, « très subtile » ou « plus subtile encore », laisse flotter dans l’air une part de mystère délicieux, impossible à cerner, une ambiance d’énigme mathématique, des sous-entendus, du sous-texte. Voilà pourquoi nous finissons aussi par l’entendre, cette « subtilitas », dans le sens de la nuance et du clair-obscur. Elle rejoint alors le monde de l’émotion... pour autant que vous vouliez bien penser l’émotion, elle aussi, dans le registre de la nuance. Les émotions humaines forment une syntaxe très raffinée, voyez-vous, et ce n’est pas sans chagrin que je vois une certaine danse contemporaine prendre le parti d’une « émotion » spectaculaire, qu’on éclaire des lumières les plus brutales. On confond le simple et le primaire. C’est alors que, bizarrement, on perd les corps, le réel des corps. On touche à l’obscène. Je voudrais aujourd’hui que l’émotion se déploie dans des demi-lumières, des couleurs transitoires, des passages perpétuels. Dans le sens qu’Arnold Schoenberg a réactivé six siècles après l’Ars Subtilior, en contestant l’idée d’une opposition dure entre consonance et dissonance, et en démontrant que, de l’une à l’autre, on pouvait passer en douceur. Doucement, ça passe.
Schoenberg écrit d’ailleurs ceci, en 1909 : «Je me détourne clairement de la sonorité pleine, celle des dieux et des surhommes de l’orchestre wagnérien. Tout devient plus tendre, plus fin. Des couleurs réfractées apparaissent là où ne se trouvaient que des couleurs claires, lumineuses.»
ATDK : Voilà... L’écriture sophistiquée des états transitoires, la polyphonie de toutes choses, ce n’est pas une affaire d’intellectuels, Schoenberg dit cela très bien, c’est d’abord une histoire de lumière. Cela peut absolument concerner un grand public, celui qui va au spectacle comme on va contempler un crépuscule. Les choses se frottent l’une à l’autre, il y a des intensités de consonance et de dissonance, des milliers d’intensités très fines, qui clignotent. C’est désormais le soir, on attend. C’est l’heure des états intermédiaires de la perception.