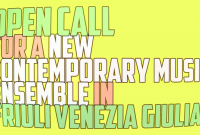Circulez, il y a tout à voir !
Ecrit pour le magazine L'Etincelle n°17 à l'occasion du festival Manifeste 2017 de l'IRCAM
et du concert d'Ictus Sound and Vision



Les concerts Liquid Room d’Ictus sont pensés comme de petits festivals thématiques : chaque numéro traite d’un problème particulier. L’édition Sound & Vision traite du corps musicien, capturé par la lumière au moment de l’accomplissement d’un geste étrange ou déroutant. Malgré de spectaculaires transformations de surface, tout un pan des esthétiques contemporaines peut continuer de se comprendre selon la boussole paradoxale de Georges Aperghis : c’est au sein du plus grand dépaysement, à l’instant de la désorientation maximale, que la question “qu’est-ce que faire de la musique ?” semble soudain la mieux posée.
Où en sommes-nous ? Une nouvelle génération très décidée investit aujourd’hui des lieux comme Darmstadt ou le MaerzMusik de Berlin ¬— je parle de la génération qui a fondé les ensembles SoundInitiative ou Nadar, par exemple. La musique d’écriture cohabite là avec des propositions non-écrites ou semi-écrites qui incluent l’installation, l’improvisation, le live encoding, les arts sonores, le drone, les performances de microphonie, etc. C’est d’eux que nous parlerons dans Sound & Vision. Il est assez aisé d’en repérer les proximités et les intérêts : art contemporain, théâtre post-dramatique, cultural studies. Et en règle générale : une aisance dans un monde multiple traversé de temporalités à différentes vitesses ; avec le danger qu’on connaît bien, celui d’un enthousiasme hilare devant l’arbre de Noël du Pluriel. Mais du moins, ça ne pleurniche pas — au contraire des modernistes déçus, calcinés par l’amour d’une histoire linéaire de la musique écrite et la promesse d’un nouveau solfège, qui n’est jamais venu.
La guerre œdipienne n’aura pourtant pas lieu. Car la question, tout à coup, n’est plus formulable en termes binaires, elle n’est plus celle d’une « next wave » qui déclasserait le répertoire précédent. Mon expérience avec Ictus se modélise plutôt selon un schéma ternaire qui est celui des anneaux borroméens. Pour les rétifs aux mathématiques, j’en ai déposé une image sur cette page, et j’en rappelle le principe : soit trois ronds de ficelle ; ils ne sont jamais attachés par deux ; c’est le rond 1 qui lie 2 à 3, le rond 2 lie 3 à 1, le rond 3 lie 1 à 2 ; si on coupe l’un des ronds, c’est tout l’ensemble qui se délie. Mon premier rond de ficelle concerne les modes de présentation et les alternatives à la représentation philharmonique du XIXe siècle. Le deuxième rond concerne les modes de collectif : de nouvelles pratiques fleurissent désormais, à mille lieues de celles de l’ensemble pensé comme mini-orchestre. Et le troisième est celui du répertoire : veut-on penser un champ en extension où la musique d’écriture se frotte à d’autres arts sonores ? Ce n’est pas un modèle évolutif à modulation lente, ni un modèle révolutionnaire qui fait exploser la situation. Il fonctionne plutôt par perturbations successives : quand ça bouge dans l’un des champs, quel qu’il soit, cela affecte le rapport qu’entretiennent les deux autres. C’est cela qui se passe aujourd’hui.
Cela dit, qu’on reconnaisse des « propres de l’art » — le propre de la musique, de l’art sonore, du théâtre, etc. — m’intéresse toujours, non pas selon une logique identitaire, pour savoir qui je suis (seul l’idiot croit qu’il est ce qu’il est) mais selon une logique du désir, où il s’agit de demander (c’est le mot-clé) : moi qui consacre tant de temps à la musique, dont l’exercice me pose des colles à l’infini, que puis-je demanderau danseur, par exemple, qui consacre lui-même tant de temps à la danse ? Le « propre » du musicien est son étrange corps au travail, et je postule paradoxalement que le corps musicien est un spectacle nécessaire et suffisant. Le concert a de l’avenir. Je me nourris en cette matière des conceptions de François Nicolas, qui pose comme condition nécessaire au musical un « corps-à-corps avec l’instrument », que j’interprète comme ceci : la production d’un son musical n’a rien à voir avec quoi que ce soit de l’ordre du déclenchement ou du stimulus, qui sont des opérations à sens unique. Le réel du travail instrumental est bien plutôt un processus d’ajustement où l’oreille corrige le geste à vitesse infinie selon des circuits très nombreux et une intuition de potier — et de mon point de vue, cela peut tout aussi bien concerner un travail sur une machine, une platine, un ordinateur, un ensemble de potentiomètres comme l’a proposé Tarek Atoui. Cela dépend seulement des possibilités d’ajustement. Par ailleurs, et toujours pour suivre librement Nicolas, le musicien n’adresse pas véritablement la musique à l’auditeur, mais adresse sa production sonore « à la musique » : il fait cap vers le musical, il invoque le musical dans l’ajustement inlassable de son geste dont les indices sont le vibrato ou l’ornement, la résistance au tempo mécanique, l’inflexion modale, la sculpture du timbre dans le temps, bref toute la « vibrance » du son musicalisé. Cela fait du corps au travail « vers la musique » un spectacle tout à fait passionnant tel quel, quand bien même le musicien bougerait peu, je veux dire quand bien même il n’ajouterait aucun signe d’expression supplémentaire. Jennifer Walshe a publié un manifeste à Darmstadt où elle conclut : « il est temps que les musiciens aient un corps », et cela me semble très à côté du problème. Le problème est plutôt de constituer des collectifs de musiciens prêts à tester leur propre type de corporalité dans toutes sortes de nouvelles situations.
En ce qui concerne les modes de représentation : la question de la participation du public, déjà posée dans les années ’70, se repose aujourd’hui en termes un peu différents. Que cela soit par le détour de la psycho-acoustique, comme l’ont approché les Spectraux, ou par une théorie de l’écoute comme décision, nous admettons aujourd’hui qu’écouter est en soi une activité richement fibrée, qui participe à l’œuvre sans qu’il soit besoin de l’accompagner de distribution de castagnettes. Il n’en reste pas moins que le dispositif du concert classique, transplanté du XIXe au XXIe siècle avec la même frontalité, la même immobilité, la même demande de silence religieux, le même défi lancé à la concentration de l’auditeur — toujours-déjà suspect d’être un hyperkinétique échappé du club de jeux vidéo sans sa prise de Ritaline — a commencé à nous taper sur les nerfs. Symptôme : les polémiques proprement sadiques concernant la toux ; comme s’il était possible d’empêcher qui que ce soit de tousser au concert... La toux nerveuse est une révolte du corps écoutant, et il suffit de dénouer un peu les lacets du corset. C’est ce que Tom Pauwels nous a convaincus de faire en inventant la série des Liquid Room, pour proposer au public une circulation fluide entre différentes scènes (histoire de choisir son angle d’écoute), en laissant le bar ouvert pour le laisser régler son attention et, si les gens toussent, on pousse le volume !
Quand le musicien de formation classique (que je suis) se tourne avec confiance vers ses camarades qui dédient leur temps aux arts sonores ou à la performance, le grimoire de la tradition ne disparaît pas pour autant en fumée dans son dos, à la faveur de je ne sais quelle fatalité de désencodage du monde ; il lui suffit de leur demander quelque chose sur leur pratique, leur façon de faire un collectif, leurs espaces, leurs modes d’écriture et leur oralité propres, et il lui sera demandé en retour — quelle œuvre écouter, vers quel compositeur se tourner pour régler tel ou tel problème, cent questions lui seront posées loin de toute problématique de chef d’œuvre. La fraîcheur de ces demandes croisées l’éloignera parfois de ses consœurs et ses confrères revêches, si prompts à juger et à s’indigner, et cet éloignement lui sera peut-être un deuil, mais tout aussi bien la promesse d’une existence plus joyeuse.